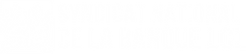L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 septembre 2025 (n° 23-22.732) consacre un revirement important en matière de congés payés. La haute juridiction confirme en effet que « le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant ses congés annuels payés a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie ».
Avant : une jurisprudence défavorable au salarié
Jusqu’à cette décision, la jurisprudence française restait majoritairement défavorable aux salariés tombant malades pendant leurs vacances. En l’absence de dispositions conventionnelles favorables, l’idée était que le congé payé était réputé acquis et consommé même si le salarié n’avait pu en profiter. Cette logique reposait sur une distinction entre “congé” et “suspension du contrat” et sur l’idée que l’arrêt maladie n’entraînait pas, par défaut, un droit à “re-vacances”.
Le tournant du 10 septembre 2025 : l’alignement avec le droit européen
La décision du 10 septembre marque donc un tournant : dans le cas où un salarié tombe malade pendant ses congés payés et que cet arrêt de travail est notifié à l’employeur, il pourra reporter ses jours de congé non utilisés ultérieurement.
La Cour de cassation s’appuie explicitement sur l’article L. 3141-3 du Code du travail, en l’interprétant à la lumière de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen, qui consacre le droit au repos et au congé annuel.
Cette solution juridictionnelle est la réponse à une mise en demeure de la Commission européenne, qui avait estimé que le droit français n’assurait pas suffisamment la protection des travailleurs malades en congé, en termes de récupération des jours de congé annuel.
Les conditions et limites du report
Toutefois, le droit au report des jours de congés payés coïncidant avec un arrêt maladie n’est pas automatique. Deux conditions doivent être réunies :
- Notification de l’arrêt : le salarié doit informer l’employeur de son arrêt maladie. Sans cette notification, le report ne peut pas être exigé.
- Preuve que les congés n’ont pas pu être réellement « pris » : la Cour distingue le congé « de repos/loisirs » et l’arrêt maladie destiné à la convalescence. Si la maladie prive le salarié de la possibilité de jouir effectivement de ses vacances, le report devient justifié.
Un arrêt de travail intervenant durant un congé, mais non déclaré à l’employeur, prive le salarié de la possibilité de réclamer ce report, selon la décision de la Cour.
En pratique : quelles conséquences pour les salariés et les employeurs ?
Pour les salariés, cet arrêt représente un renforcement significatif de leurs droits : tomber malade pendant ses vacances ne signifie plus perdre ses jours de congé payés. C’est une reconnaissance que la “vacance” et la “maladie” ne sont pas la même chose, et que la seconde ne doit pas faire disparaître les bénéfices de la première.
Du point de vue des employeurs, ce revirement impose de nouveaux ajustements en matière de gestion des congés et de la paie. Il faudra désormais traiter les situations où un salarié signale un arrêt maladie survenu en cours de congés, afin d’organiser le report des jours correspondants — ou, s’il y a eu trop-perçu d’indemnités de congé, de recalculer ce qui est dû ou non. Des litiges pourraient émerger si l’arrêt n’a pas été correctement notifié.
À retenir
L’arrêt du 10 septembre 2025 de la Cour de cassation consacre une avancée majeure pour les salariés malades pendant leurs vacances : les jours de congé coïncidant avec un arrêt maladie peuvent désormais être récupérés, à condition d’avoir informé l’employeur. Ce revirement met fin à une jurisprudence restrictive, et aligne le droit français sur les exigences du droit de l’Union européenne.